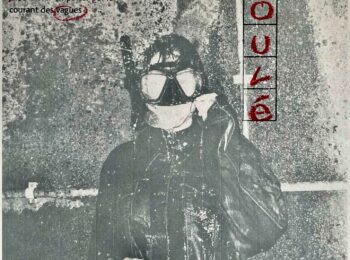« Grand chapeau en guise d’ornement, costume noir et sourire, cet homme a de la prestance ! Il est accompagné par un synthé, une guitare, une basse et une batterie. Les lumières scintillent, la scène est violette et deux jeunes filles qui se trémoussent derrière nous lâchent des “J’adore, j’adore!” à tout va. Cette fois-ci les sonorités africaines accompagnent des textes en français. Ça bouge et ça swingue avec classe. L’artiste entame des titres tels que “Bipolaire – les noirs”.
“Comment faire l’amour à un noir sans se fatiguer, Il faut le surmonter, il faut l’immobiliser…” »
Nous vous parlions de Baloji dans notre report du second jour des Fiesta des Suds.
Quelques heures avant son apparition sur scène, l’artiste a répondu à nos questions, installé dans un canapé du Mucem, face aux baies vitrées surplombant la mer.
Aujourd’hui vous venez défendre votre album « 137 Avenue Kaniama » pour la première fois à Marseille.
Pour vous, est-ce un projet d’album avant toute chose ?
Oui et non. Je fais parti des artistes qui ont survécu grâce au live. J’ai sorti mon premier album en 2008 et j’ai fait une version congolaise de cet album en 2010. Lorsque je l’ai envoyé à EMI et aux gens d’Universal France chez qui j’étais signé en édition, j’ai eu le droit en direct à 3 ou 4 AVC. On me disait : « Il est hors de question que tu sortes ce disque ».
Ce qui m’a maintenu en vie entre 2011 et 2016, c’est le fait d’être sur scène. Grâce aux visuels, ce projet m’a permis de tourner à travers le monde et de découvrir quelque chose qui me semblait complètement impossible. Je vivais vraiment dans le prisme de la musique francophone au sens large, je ne pensais donc jamais aller à l’international. Ce disque m’a permis de voyager et de faire le tour du monde. En concevant le disque, on a pensé avant tout au live et aujourd’hui on a la chance de vendre plus de tickets dans des pays non francophones.
Dans le fond, aujourd’hui, quel est l’intérêt de faire un album ?
Cela repose uniquement sur une chose « L’envie », l’envie de raconter quelque chose. Je crois que cela va être la chose la plus bête que vous allez entendre de tout le festival, mais concevoir un album c’est hyper ludique. Même si les thèmes paraissent hyper graves, pour moi faire de la musique c’est presque jouissif, c’est un jeu. Je le vois comme ça plutôt que comme quelque chose qui demande de la discipline, du factuel et du formel. C’est un tel privilège d’être un artiste en 2018 que quand tu as la possibilité de le faire, tu dois juste te faire plaisir.
Vos albums ont plusieurs niveaux de lecture qui se superposent : au niveau musical il y a une fusion d’éléments qu’on n’a pas toujours l’habitude d’entendre ensemble, au niveau textuel il y a souvent un aspect narratif et littéraire. Pour vous, est-ce qu’avec la joie de réaliser un album il y a aussi le plaisir de raconter une histoire ?
Oui, je kiffe raconter des histoires. Joseph d’Envers a cette phrase que j’adore : » On entre dans une chanson par la musique, on y reste pour les textes « . J’aime bien aborder la musique de cette manière, en me disant que certains éléments vont être prédominants à la première écoute : la musicalité, les mélodies. Puis, si on y passe du temps, on peut apercevoir le sous-texte du sous-texte. Avoir plein d’éléments narratifs pas évidents à mesurer m’amuse énormément. Par exemple, si on survole l’album, il est possible de ne jamais entendre la chanson phare « Inconnu à cette adresse ». Ce genre de chose m’amuse assez.
Il y a aussi des thèmes qui reviennent régulièrement, tant dans cet album que dans le précédent : le thème de l’artiste au travail notamment. N’auriez-vous pas la volonté de casser le mythe de l’artiste qui vie sur un petit nuage ?
Il y a deux choses différentes.
Je n’ai pas du tout été à l’école, je me suis arrêté au secondaire. Pourtant, j’ai un rapport presque studieux à la musique et l’écriture. Je pose ma fille à l’école, je prends mon café, je lie le journal, puis je me sens au boulot : je suis au bureau. Je bosse jusqu’à 17h45 comme un mauvais père et je vais chercher ma fille au moment où ils ferment. Il y a quelque chose d’hyper rigoureux dans ma manière d’être artiste. La métaphore sportive « Practice make it perfect » correspond à ma façon de travailler. Travailler tous les jours faits qu’on arrive à mieux raconter les choses, cela permet d’acquérir une maîtrise de son outil.
En parallèle, je fais une musique qui n’est vraiment pas facile d’accès. C’est compliqué de trouver des gens pour l’accompagner. Si j’arrive à le faire, c’est vraiment parce que je me bats pour que ça existe.
Aujourd’hui je suis chez Bella Union. Après un clip, ils arrêtent. On bosse la promo pendant 45 jours et si cela ne prend pas c’est au tour du suivant. Les filles de la promo sont hyper charmantes, hyper avenantes, tout le monde est hyper adorable et tu pourrais te laisser piéger en te disant que ces gens t’aiment. Mais si ça ne prend pas, tout le monde passe à autre chose.
J’ai fait mon premier album en 2008 et j’ai compris qu’aujourd’hui on peut mourir dans l’anonymat le plus complet, tout le monde s’en fou. Au final c’est important de garder cette notion en mémoire afin de se demander pourquoi on fait tout ça. Tant que tu n’as pas une notoriété, les gens s’en foutent. Si tu le fais, il faut être un peu fou, car c’est toute une galère.
Comment expliquez-vous cette difficulté à accrocher les producteurs ? Est-ce parce que vous avez ce côté inclassable ?
Je pense que c’est un ensemble de choses. Tout à l’heure j’en parlais par rapport au surréalisme belge. Je crois que je dois incarner ça : un truc mâle alpha et en même temps androgyne, une musique assez sexuée, mais aussi très scénique et très écrie, avec un rapport à l’image puisque je fais moi-même ma réalisation, mes visuels. Voici un bel exemple : mon label avait 800 euros pour que je fasse ma pochette d’album et c’est une pochette qui m’a couté 9 000 euros. J’ai dû aller chercher l’argent, c’était le parcours du combattant pour faire cette pochette. À des moments, je me demande pourquoi je veux absolument la faire, mais en même temps pourquoi pas !
Je veux allez au bout de mon idée, mais ça rend dingues les acteurs de l’industrie musicale : « Pourquoi tu veux allez dans la jungle pour aller faire ta photo d’album avec des pygmées qui vont te faire un hôtel de mariage ? ».
C’est une catastrophe pour mon compte en banque, mais c’est juste que je veux aller au bout de mon projet, aller au bout de comment je l’ai conçu et pensé. Cela n’a pas de prix en fait. C’est compliqué pour l’industrie dans laquelle je me trouve, pour un artiste « d’eau douce » comme on dit en Belgique. Pour des artistes comme moi, il n’y a pas de moyens. Mon clip « Peau de chagrin/Bleu de nuit » coûte 35 000 euros et mon label m’en donne 2 000. C’est l’exemple d’un clip et j’en ai fait 5, c’est presque suicidaire.
Ce soir, c’est un retour à Marseille, vous étiez venu pour le Babel Med et vous aviez reçu un prix. Que vous inspire cette ville ?
Je suis ravi d’être ici, c’est la ville de mon idole « Le Rat Luciano », c’est mon icône rap absolu.
Je trouve aussi que la gentrification arrive à Marseille, c’est la deuxième chose que je me suis dis en arrivant tout à l’heure.
Il y a un truc assez particulier ici, les quartiers populaires sont en plein centre-ville, c’est quelque chose d’atypique dans l’architecture française. La géographie est particulière. Je sais qu’il y a une grosse communauté comorienne, c’est à ça que je pense quand je suis ici, aux Comores, à une église qui a des allures de mosquée, ce genre de chose.
Le Français reste votre langue numéro 1, mais le fait d’être écouté à l’international vous incite-t-il à explorer d’autre langues ?
Initialement j’avais pensé faire mon album en mode « Christine and the Queens », en anglais. Ça ne me venait pas du tout d’elle, ça me venait des Adamo, des Aznavour qui avaient toutes leurs chansons en plusieurs langues. Adapter sa langue au public c’est hyper élégant et bienveillant. Il y a quelque chose d’assez logique à s’exprimer dans la langue de son auditoire, c’est une démarche saine. J’ai voulu le faire, mais pour des questions de budget on n’a pas pu. Cela reste en français. On a trois titres sur la playlist de BBC et c’est formidable que du français soit sur la BBC, surtout à notre époque.
Pourriez-vous choisir le morceau qui vous a semblé être le plus dur à écrire et nous raconter son histoire?
Je crois que celui qui m’a pris le plus de temps c’est « Tanganiaka » parce que c’est le plus long, mais il était assez fluide en terme d’écriture. Il y a aussi celui que j’ai terminé d’écrire la veille de l’enregistrement, la chanson titre, c’est « Inconnu à cette adresse ».
Mais celui qui m’a pris beaucoup de temps c’est« Bipolaire les noirs » parce que j’ai un contrat et l’obligation de ne pas être dénigrant dans mes propos par rapport à mon ex-employeur, Universal France. Je devais donc être précis, cela a été compliqué.
Ce morceaux à d’ailleurs plusieurs niveaux de lecture ?
Oui. Il y a plein d’histoires et je joue avec le fait que l’on parle d’un couple mixte alors que ce n’est pas du tout le cas. À l’inverse, tout est très précis : « Au premier rendez-vous, Rue Fossé-aux-loups, Tu m’as dit aimer beaucoup, Mon allure et mon bagout ». Il y a plein de petites références à comment fonctionne l’industrie du disque : les bons à tirer, les bureaux des DA avec des posters de 50 Cent » Ton bureau une chambre d’ado, Avec des posters de Noirs tout en pectos, Pourtant Majeur depuis Chirac, Tu crois encore que ta salive est aphrodisiaque, Dans tes élans de sollicitude, Pour les gens du Sud, Chez vous l’empathie est un mécanisme, Appris au catéchisme « .
Celui-ci était difficile à écrire en effet.
À ce sujet, comment écrivez-vous vos morceaux ?
Je commence toujours par trouver le thème, puis la musique et seulement après j’écris. L’écriture c’est le troisième temps.
Est-ce qu’une de vos missions serait de déconstruire les clichés, notamment celui lié à la couleur de peau, quelle qu’elle soit ?
C’est quelque chose qui m’intéresse.
J’aimerais rajouter quelque chose à la question précédente « Peau de chagrin, bleu de nuit » n’est pas quelque chose de simple à écrire non plus. Parler de l’après-acte sexuel est quelque chose que j’ai hésité à faire. Quand on parle de déconstruire, je suis en plein dedans en parlant de l’après-érection, de la vulnérabilité, de ce moment où tu te sens presque inutile en tant qu’homme.
J’ai essayé de chercher dans la chanson française si d’autres artistes avaient abordés le sujet, j’ai trouvé des chansons qui parlent de la sexualité féminine, du point de vue masculin, d’être impressionné par les ressources infinies de la sexualité féminine, mais il y a un rapport qui est de l’observation. Je n’ai rien trouvé en rapport avec ce sentiment d’inutilité. On reste toujours sur quelque chose de très phallique, de conquérant. Se mettre dans cette posture-là casse le mythe, après ça le dossier est clos.
L’attaché de presse nous indique alors que la conférence doit se terminer, les journalistes se retirent alors et l’artiste rigole en nous disant que c’est une drôle de façon de terminer l’interview compte tenu du dernier sujet. Puis on rigole tous en se donnant rendez-vous au concert de Baloji quelques heures après.
Nous remercions l’équipe presse de la Fiesta des Suds ainsi que l’artiste, fort sympathique.
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR :
- Rédactrice en chef adjointe et webmaster d'Extended Player. Amoureuse du rap français et des bonnes punchlines, je pilote la section rap du mag depuis que j’ai 11 ans (oui, déjà !). En parallèle, je suis communicante freelance et chef de projet web, avec une expertise en e-commerce. Toujours connectée, toujours à l'affût des sons qui parlent et qui touchent !
DERNIERS ARTICLES DE L'AUTEUR:
 Événements - Festivals11 novembre 2025Fiesta des Suds 2025 : La Valentina, l’explosion scénique qu’on attendait
Événements - Festivals11 novembre 2025Fiesta des Suds 2025 : La Valentina, l’explosion scénique qu’on attendait HipHop - Rap17 octobre 2025Interview – Melzak : “J’ai compris le pouvoir des mots quand j’ai commencé à perdre des gens”
HipHop - Rap17 octobre 2025Interview – Melzak : “J’ai compris le pouvoir des mots quand j’ai commencé à perdre des gens” Événements - Festivals4 juillet 2025Kofs à l’Affranchi : une première date entre retour aux sources et projection d’avenir
Événements - Festivals4 juillet 2025Kofs à l’Affranchi : une première date entre retour aux sources et projection d’avenir Événements - Festivals3 juillet 2025IAM au Vélodrome : 40 ans de carrière célébrés en demi-teinte
Événements - Festivals3 juillet 2025IAM au Vélodrome : 40 ans de carrière célébrés en demi-teinte