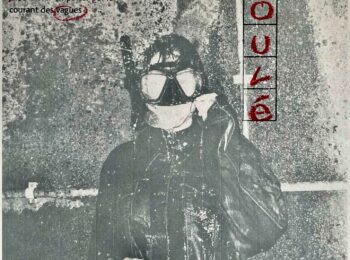Paul Wamo, musicien calédonien de renom a donné un concert le 15 mars dans le cadre de Babel Med 2017, le festival de musiques du monde de Marseille. A cette occasion, notre équipe l’a rencontré pour recueillir ses impressions du concert, sa vision de la musique et parler de sa terre natale.
Paul Wamo, musicien calédonien de renom a donné un concert le 15 mars dans le cadre de Babel Med 2017, le festival de musiques du monde de Marseille. A cette occasion, notre équipe l’a rencontré pour recueillir ses impressions du concert, sa vision de la musique et parler de sa terre natale.
Extended Player : Bonjour Paul, Tu es venu à Marseille spécialement pour ton concert à Babel Med ?
Paul Wamo : J’habite à Marseille, ça fait un an que je suis installé parce qu’il fait beau, il y a le soleil, la mer… Non je rigole je suis venu à Marseille par rapport à notre projet artistique et musical. On travaille ici avec la Clique Production, une boite de production marseillaise. On est là pour le travail mais aussi pour le temps.
EP : Quels projets artistique développes-tu en ce moment ?
PW : Moi je suis dans le slam… enfin plutôt dans l’oralité mais aussi l’écriture, donc des projets qui tournent autour de ces thèmes. Il y a le pôle musique qu’on a présenté à Babel Med Music, le pôle littérature : des recueils de texte publiés dernièrement, et la création scénique: la création de spectacles. L’an dernier on a créé deux spectacles en région parisienne autour de l’oralité et de l’écoute.
Je suis aussi sur un autre projet musical de spectacle-concert en duo de dub poetry, c’est-à-dire des textes mis en musique. Le dub poetry est un style musical né dans les années 70 en Jamaïque, des poèmes mis en reggae avec des sound system. Des DJs lancent leurs disques et invitent des poètes à venir dire leurs textes, tout ça sur fond de musique reggae. LKJ est le poète le plus reconnu dans ce style.
Notre idée est de faire un dub poetry océanien, mettre des textes d’auteurs océaniens comme Denis Pourawa, Chantal Spitz et plein d’autres de notre zone en musique.
On est aussi en préparation de notre deuxième album qui sortira au mois d’octobre, produit ici à Marseille.
EP : On te qualifie de rappeur, slammeur, chanteur, ect. Finalement ton art n’est-il pas la parole du chef tribal au sens anthropologique. Il y a des études faites autour de cette parole du chef dans les tribus non coercitives où la parole du chef rappelle le sens de la vie ensemble. Tu t’inscris dans cette définition ou tu essaies de faire quelque chose de plus moderne ?
PW : La première fois que j’ai dit un texte, je ne me suis pas posé cette question. C’est parce que j’avais envie de sortir des choses de mon crane alors j’ai commencé à écrire. Il n’y avait de rapport avec la chefferie, j’avais envie de m’exprimer. Chez nous en Nouvelle-Calédonie la parole a une place importante, dans les rituels, les cérémonies coutumières, on est baignés dedans, par exemple lors de mariage ou de deuil.
Quand on va chez quelqu’un, on arrive avec un rituel : on amène un objet, un présent qui est toujours accompagné d’un discours. Quand tu arrives chez la personne et que tu poses ce discours-là, le temps s’arrête et la parole est mise en avant. On est vraiment baignés dans cet esprit-là. Cette place de la parole au pays m’a habité la première fois que j’ai dit un texte. Je ne me suis pas posé cette question au départ, même si je fais partie d’un clan au pays, qui s’appelle le clan de la parole.
On peut rattacher plein de styles différents à mon travail. Moi je dis simplement que c’est de l’oralité de la parole.
EP : Est-ce que cette oralité dont tu parles et dont tu t’inspires, elle ne se perd pas en passant à l’écriture ? L’expression change, elle peut se figer quand on la couche à l’écrit.
PW : Moi je suis un parolier, je dis ce que j’écris, c’est complémentaire. Mais ta question peut interroger le rapport aux langues par exemple. Nous en Nouvelle Calédonie, on a 24 langues dont 10 écrites et d’autres seulement orales et beaucoup de locuteurs ne veulent pas que leur langue soit écrite, car justement ils pensent qu’on peut perdre le sens en mettant la langue orale à l’écrit. En même temps les enfants ne parlent plus la langue et on a envie de partager notre langue.
Au pays maintenant on a beaucoup perdu d’oralité alors on essaie de faire en sorte d’écrire car l’écriture fige. On a besoin de ça pour transmettre tout ce qui arrive actuellement. On est assailli par la mondialisation, les Mac Donald’s, les grosses machines. L’écriture est essentielle pour essayer de garder nos valeurs et la transmettre aux jeunes qui ne parlent pas la langue. C’est un plus et un moins car cela efface la spontanéité et le contact direct. On est feignant quand on écrit aussi ! Quand on transmettait les choses à l’oral, on était en contact.
EP : Tu peux nous parler de ta langue ?
PW : Ma langue c’est le Drehu, c’est la langue de l’île de Lifou, c’est une des langues les plus parlées. Elle est écrite et enseignée. Il y encore plusieurs pays kanak et chaque pays à sa langue et mon pays est le Drehu.
EP : En habitant en Métropole, arrives-tu à trouver le moyen de rester immergé dans cette culture kanak, de garder tes racines ?
PW : Oui bien sûr. Moi j’ai grandi en ville à Nouméa, mais nos pères quand ils sont venus en ville pour travailler, ils ont amené la culture avec eux. Donc aujourd’hui, pour les mariages, pour les deuils on suit les coutumes ancestrales mais en s’adaptant à l’espace. Même ici il y a une communauté kanak et on se réunit pour ces événements, on fait les cérémonies même dans un petit appart’. On a ça en nous, je peux aller aux pôles, j’amènerai ça avec moi et si je vais chez quelqu’un je vais perpétuer la coutume, telle que je l’ai faite hier soir sur scène.
EP : Tu jouais hier avec deux musiciens marseillais, quelle est ta configuration musicale ?
PW : J’évolue seul mais je me suis entouré de musiciens locaux pour la production de mon nouvel EP, essentiellement de percussionnistes et d’une guitare. J’ai la ligne musicale, la mélodie en tête, je la propose au compositeur qui se débrouille avec.
Il y a une riche scène musicale en Nouvelle Calédonie, de la musique traditionnelle aux formes modernes comme le Kaneka, la musique contemporaine kanak, qui s’inspire des rythmes traditionnels et se marie au jazz, au blues, au rock, au reggae toujours avec des percussions. Ce style musical est né dans les années 80 avec Jean-Marie Tjibaou qui avait commencé la revendication identitaire lors des Evènements. A l’époque les musiques que l’on entendait à la radio, blues, rock, jazz venaient toutes d’ici. C’était la référence pour les musiciens kanak, ils prenaient les mêmes patronymes, portaient les pantalons pattes d’éléphants et la coiffure afro. Il y avait un peu une honte d’être Kanak en tant que personne. Jean-Marie Tjibao est arrivé avec un discours fort, rassembleur, plein de fierté et il a voulu créer un style musical qui nous ressemble et qui puisse passer à la radio. Les musiciens se sont regroupés, ont rencontré des ethnomusicologues, en quelques semaines ils ont testé et créé. C’est comme ça que le Kaneka est né. A la base c’était une musique revendicatrice.
EP : Quelles sont tes inspirations musicales contemporaines ?
PW : La première personne qui m’a enseigné la scène c’est Jacques Brel, un grand monsieur pour moi. Quand j’ai découvert Jacques Brel, je me suis dit qu’il était fou, il sait ce que c’est d’être sur scène. Quand on monte sur scène, avec mes musiciens on se dit que c’est comme un match. On reste sur le terrain du premier au dernier coup de sifflet et on donne tout ce qu’on a et après on peut mourir.
J’ai plein d’inspirations… Bob Marley aussi mais je suis ouvert, j’aime quand ça groove. C’est ça mon inspiration.
EP : Sur scène on sent une certaine rage dans ton expression, tu sensibilises beaucoup ton public à la situation actuelle en Papouasie Nouvelle-Guinée, en tant qu’artiste kanak d’expression française que penses-tu du prochain référendum (ndlr : sur l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie) ?
PW : Je ne sais pas si on cherche l’indépendance mais en tout cas on souhaite l’autonomie.
Je ne pense pas qu’un pays dans le monde soit indépendant mais plutôt inter-dépendant.
Dans les accords de Nouméa dans les années 1950, la France s’est engagée à laisser le pays libre et autonome et à l’auto-détermination par transfert de compétence pour réussir une bonne « décolonisation ». La France a tellement assisté la Nouvelle-Calédonie que l’autonomie nous déstabilise, on ne souhaite plus trop partir finalement. Comme tout peuple colonisé on a cette malédiction au-dessus de nos têtes. Le dernier livre de Frantz Fanon « Les Damnés de la Terre » explique en détail la psychologie de ces pays-là, on peut retrouver la Calédonie dans son ouvrage. C’est compliqué mais on y arrivera car on a chez nous une ressource humaine qui est plus importante que la ressource minière et grâce à notre position stratégique au milieu du Pacifique, on se dit que peut-être la France non plus ne veut pas nous lâcher… mais on ne sait pas ce qui se manigance dans les bureaux.
Mon rêve pour le pays mais aussi pour le monde entier – je ne suis pas économiste, pas politicien, je suis dans la poésie, dans mon imaginaire – c’est que l’on soit bien, que l’on puisse manger, qu’il y ait de la place pour tout le monde. Nous les kanak on a une culture qui laisse de la place à chacun, on est tous kanaks si on veut. Voilà ma vision utopique à moi, que l’on soit libérés de nos chaines.
EP : Merci pour cette interview
PW : Merci à vous et comme on dit chez nous quand on se quitte É a cela qui se traduit par on est là. Ça veut dire que même si on se quitte on est toujours là les uns pour les autres parce qu’on s’est vu et parlé, le moment qu’on a passé restera gravé pour l’éternité, on est toujours ensemble même si on ne se voit pas.
Interview réalisée par Vincent Carlier et Raphaël Carlier le 16/03/2017
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR :
- Musicologue, musicien et rédacteur spécialisé en musique Pop et électronique.